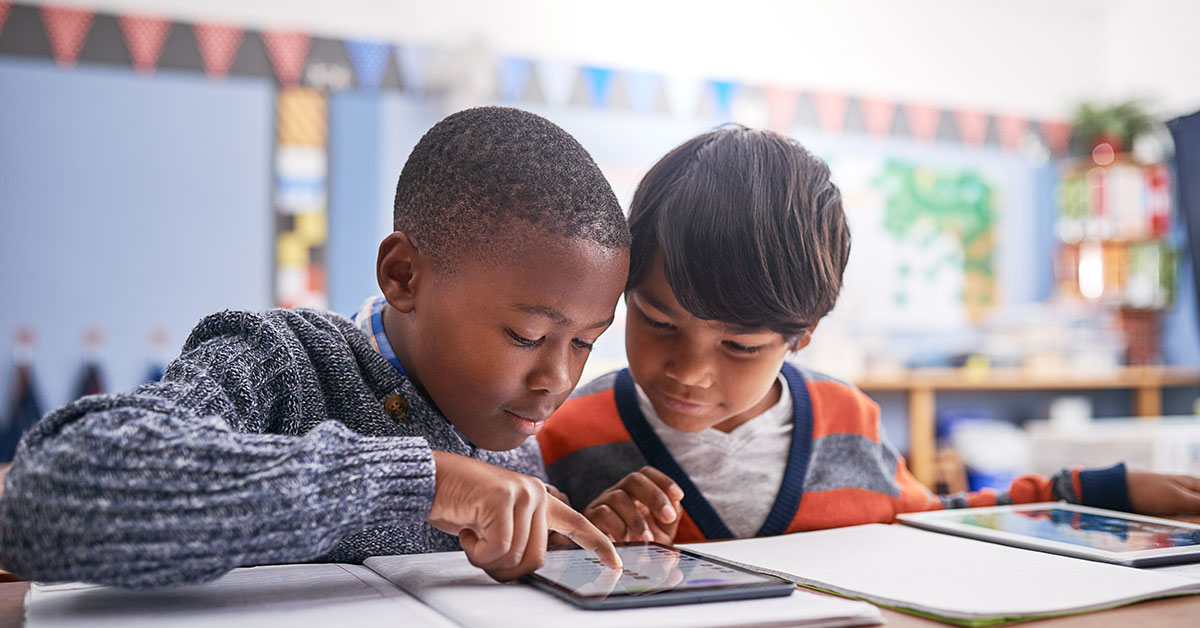1. Qui supporte réellement le coût de la guerre commerciale actuelle ?
Pour l'instant, ce sont principalement les exportateurs, mais les consommateurs américains seront également touchés par une inflation plus élevée (en hausse de 0,6 point de pourcentage d'ici mi-2026). Si les routes commerciales mondiales ont changé, permettant aux exportateurs d'atténuer l'impact, les risques de ralentissement restent élevés, car les enquêtes sectorielles se poursuivent et l'accord commercial avec la Chine est toujours en suspens. Les pertes à l'exportation pourraient en théorie aller de -0,3 % du PIB (UE) à -1,3 % du PIB (Vietnam) par rapport à un scénario pré-guerre commerciale. Le coût pour les États-Unis est estimé à -0,3 %. Les engagements des investissements directs à l'étranger (IDE) aux États-Unis, s'ils se concrétisent, représenteraient 6 % du PIB américain d'ici 2026-2028, ce qui semble très coûteux pour les pays d'origine. Dans l'ensemble, la croissance du commerce mondial des biens et services devrait ralentir pour s'établir à +0,6 % en 2026, contre +2 % en 2025 en termes de volume.