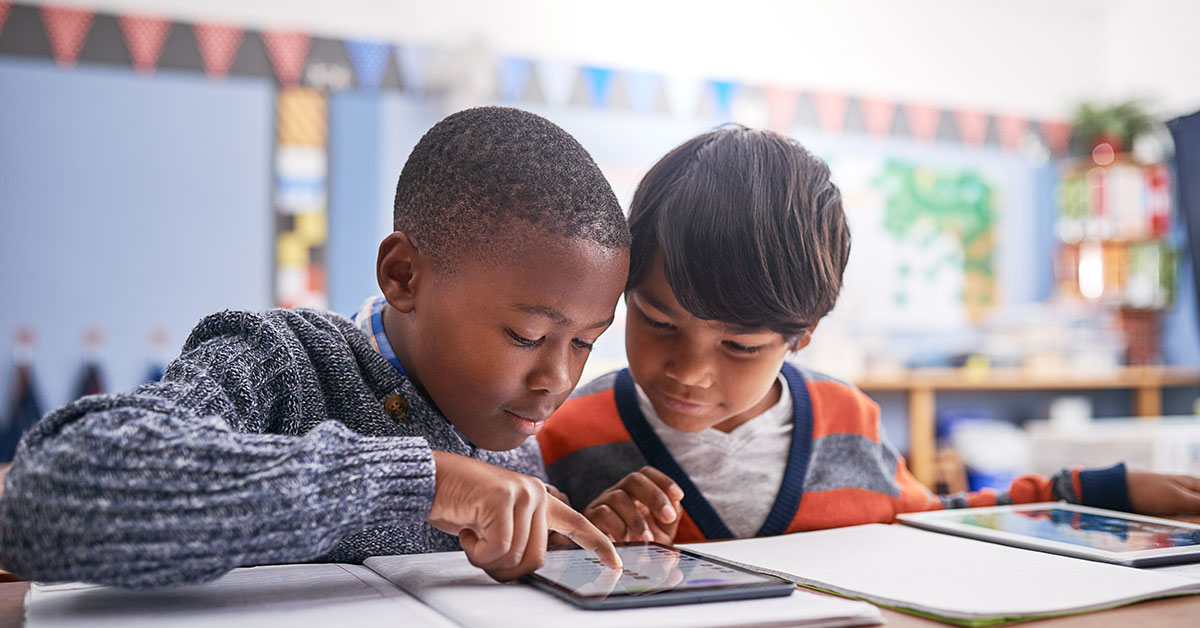D’anciennes routes commerciales pour de nouvelles guerres commerciales ?
06/11/2025
Dans un monde divisé par la géopolitique, le protectionnisme et les effets du changement climatique, le commerce mondial trace de nouvelles voies
Les routes établies continuent de transporter plus de la moitié du commerce mondial. Cependant, la logistique mondiale est devenue plus vulnérable aux chocs depuis la pandémie et une perturbation importante de l'approvisionnement peut entraîner un doublement temporaire des tarifs de fret conteneurisé. Cette catégorie « essentielle » comprend le canal de Suez (12 % du commerce mondial), Malacca (40 %) et le détroit d'Ormuz (environ un cinquième du pétrole mondial et 20 % du GNL), ainsi que les artères commerciales intérieures et côtières (par exemple, le Rhin et le Danube en Europe, le Yangtsé en Chine), les mégaports (Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou en Chine ; Los Angeles, Long Beach, Oakland aux États-Unis ; Rotterdam, Anvers-Bruges et Hambourg en Europe) et les aéroports (par exemple, Hong Kong, Londres Heathrow, Dubaï et Francfort). Cependant, notre tableau de bord exclusif sur les points de congestion montre que les hubs asiatiques et européens sont de plus en plus exposés aux risques politiques ou climatiques. Les canaux de Suez et de Panama figurent en tête de liste des points de congestion à haut risque, en raison de leur encombrement et de l’absence de routes alternatives en cas de fermeture partielle. Les hubs asiatiques sont en tête en termes de capacité et de fiabilité, mais sont confrontés à des risques politiques croissants ; les ports européens disposent d'infrastructures solides et de solutions et routes alternatives, mais sont de plus en plus exposés aux risques climatiques, en particulier dans le sud. Les hubs intermédiaires, du Moyen-Orient à l'Afrique australe, constituent des piliers d'efficacité, mais restent vulnérables aux tensions politiques et environnementales. En Amérique, la fiabilité est élevée, mais la capacité se resserre le long des côtes de l'Atlantique et du golfe du Mexique. Avant la pandémie de Covid-19, les prix du pétrole étaient le principal moteur des tarifs de fret conteneurisé. Cependant, depuis le quatrième trimestre 2020 et les tensions entre l'offre et la demande post-pandémie, les volumes de conteneurs sont devenus un facteur clé de la dynamique des tarifs de fret. Nous constatons qu'un déficit de l'offre de 20 % des volumes de conteneurs (équivalent à près du double du volume transitant par le canal de Suez) entraînerait un doublement des taux de fret d'une année sur l'autre. En outre, ce nouveau paradigme signifie également que les entreprises doivent faire face à des coûts de transport beaucoup plus volatils : la volatilité des taux mondiaux des conteneurs a triplé depuis la pandémie.
Parallèlement, de nouvelles routes apparaissent pour accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement, éviter la pression sur les coûts et répondre à l'augmentation des connexions Sud-Sud. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, des changements majeurs ont eu lieu le long des routes commerciales reliant la Chine et l'Europe, ainsi que l'Inde et l'Europe. Le fret du corridor central a bondi, avec une augmentation du volume de marchandises transportées de +86 % en glissement annuel en 2023, et celle du volume ferroviaire kazakh de +63 % en 2024. Les itinéraires de contournement autour du cap de Bonne-Espérance ont également refait surface en tant que substituts fiables, mais coûteux, aux transits par la mer Rouge, tandis que les corridors de nearshoring nord-américains et les corridors sud-nord visant à relier l'Asie du Sud au marché européen (y compris le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe) se développent également. En Amérique latine, l'un des principaux itinéraires émergents dans l'axe Pacifique-Amérique latine est symbolisé par le nouveau port de Chancay au Pérou, financé par la Chine, qui acheminera des minéraux essentiels et des exportations agro-industrielles vers les marchés chinois et de l'ASEAN. Cela illustre la deuxième phase de la Belt and Road Initiative (BRI) – « BRI 2.0 » – axée sur des actifs ciblés et à vocation commerciale dans des régions alignées sur les intérêts de la Chine en matière de matières premières. Cependant, la gouvernance et les intérêts stratégiques des grandes puissances pourraient limiter l'utilisation de ces nouvelles routes, créant ainsi des terminaux sous-utilisés, un risque que les opérateurs et les investisseurs doivent garder à l'esprit.
Pour l'instant, les routes conditionnelles telles que la route maritime nordique de l'Arctique ou les lignes interocéaniques latino-américaines restent des paris stratégiques, mais leur rentabilité est lointaine sans une réduction substantielle des risques. Moscou modernise les ports de l'Arctique et construit des brise-glaces nucléaires et des systèmes de contrôle numérique du trafic, envisageant une passerelle Asie-Europe ouverte toute l'année (avec une projection de 200 millions de tonnes de GNL arctique d'ici 2030). L'Arctique offre un potentiel à long terme (en particulier pour l'énergie), mais il s'agit actuellement d'une voie secondaire incertaine entre la Chine et la Russie plutôt que d'un corridor principal, la participation occidentale restant minime en raison des sanctions, des coûts et de la saisonnalité. Les routes de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine sont également conditionnelles.
Dans le contexte de ces changements, de nouveaux pôles commerciaux et industriels redessinent la carte du monde. Notre classement actualisé des pôles commerciaux de nouvelle génération pour 2025 montre que les économies se repositionnent sur trois niveaux – multimodal, logistique et intermédiaire – alors que les droits de douane, les sanctions et les changements dans la chaîne d'approvisionnement remodèlent les flux mondiaux. Les Émirats arabes unis (n° 1) et la Malaisie (n° 3) sont en tête en tant que puissances multimodales consolidées, grâce à leurs ports de classe mondiale, Jebel Ali et Port Klang, qui relient l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Le Vietnam se hisse à la deuxième place, soutenu par la forte augmentation de ses exportations et un nouvel accord tarifaire avec les États-Unis qui consolide son rôle au cœur du réacheminement de la production asiatique. L'Arabie saoudite (n° 4) enregistre la plus forte progression, gagnant 11 places, grâce à la baisse des droits de douane (~4 %) et à la croissance des exportations non pétrolières qui élargissent son potentiel commercial. Le Kazakhstan (n° 16) rejoint le peloton de tête en tant que nœud logistique central, avec les hubs de Khorgos et Nur Zholy qui acheminent davantage de fret eurasien. Plus bas dans le classement, la Thaïlande (n° 8), l'Inde (n° 12) et l'Afrique du Sud (n° 23) sont à la traîne en matière de connectivité malgré des terminaux de classe mondiale tels que Laem Chabang et Tanger-Med, tandis que l'Indonésie (n° 11) et le Bangladesh (n° 15) sont confrontés à des déficits d'investissement dépassant 1 000 milliards de dollars. Ensemble, ces hubs dessinent un système commercial plus large, plus régional et indéniablement multipolaire.
Avec un déficit d'infrastructures commerciales de plus de 10 000 milliards de dollars d'ici 2035, dont 7 100 milliards concentrés dans les marchés émergents, le financement doit s'adapter en conséquence afin de maintenir les taux de fret sous contrôle. Les modèles de financement se divisent en deux catégories : les actifs stables et à faible rendement sur les routes existantes, et les projets à haut risque et à haut rendement sur les corridors en expansion ou conditionnels. Les banques multilatérales et nationales de développement restent le pilier central, catalysant une augmentation de 23 % des co-investissements privés dans les marchés émergents en 2023, tandis que les fonds souverains du Golfe et les plateformes régionales telles qu'Africa50 émergent comme des investisseurs stratégiques actifs. Près de 90 % des nouveaux fonds d'infrastructure lancés depuis 2024 ont un mandat climatique ou ESG, ce qui témoigne d'une évolution structurelle vers des financements verts et mixtes. Les économies avancées continuent de dominer grâce à des marchés de capitaux profonds et des partenariats publics-privés (PPP) matures, tandis que des programmes tels que le Global Gateway de l'UE (300 milliards d'euros) et le PGII du G7 (600 milliards de dollars) visent à attirer des capitaux privés dans les pays du Sud. La BRI 2.0 de la Chine, avec 100 milliards de dollars supplémentaires promis en 2023, reste une force centrale, qui se concentre désormais sur des projets plus petits et plus verts. Pourtant, le financement reste inégal : les pays à faible et moyen revenu n'attirent que 20 % du total des investissements privés dans les infrastructures.
À l'horizon 2030, le financement des corridors évoluera vers des plateformes programmatiques, mixtes et alignées sur le climat, intégrant les ports, l'énergie, le numérique et les transports. Les garanties, les instruments liés à l'ESG et les cadres PPP standardisés soutiendront les nouvelles routes commerciales telles que Lobito, l'ASEAN et la liaison Inde-Moyen-Orient-Europe. Les gagnants de la prochaine décennie, qu'il s'agisse des gouvernements, des entreprises ou des investisseurs, seront ceux qui renforceront les acteurs en place, réduiront les risques à grande échelle et éviteront les actifs bloqués, transformant ainsi la connectivité résiliente en une source essentielle de compétitivité mondiale.